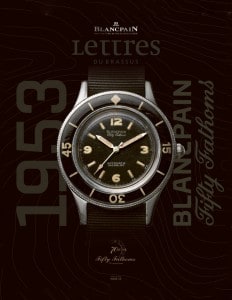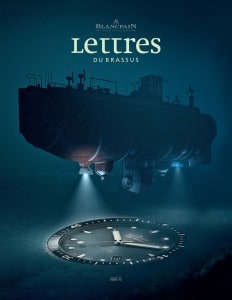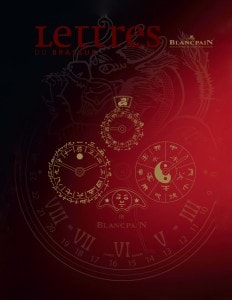Rechercher dans les numéros
Chapitres
Liste des sections
Chapitre 6
Dîner à BEIJING
Pèlerinage aux sources à Beijing : le canard à la pékinoise et l’agneau de Mongolie.

DEUX TEMPLES de la gastronomie chinoise aux contrastes affirmés.
Si vous souhaitez passer pour le benêt de service lors d’un prochain cocktail, tenez des discours enflammés sur la mondialisation comme si vous offriez des perles de sagesse à vos interlocuteurs. Ainsi, vous avez vécu dans une grotte à l’écart du monde au cours des deux dernières décennies ? Et quelle révélation s’est imposée à vous ? Assurément, nous vivons dans un village planétaire aux liens de plus en plus étroits et ce phénomène connaît une accélération constante. Aussi évidente soit-elle dans de nombreux domaines, la mondialisation ne semble jamais si profondément ancrée que dans l’univers de la gastronomie. De nos jours, toute ville de quelque importance vit en osmose avec les saveurs du monde. Pour les découvrir, il n’est plus nécessaire d’entreprendre un long voyage, il suffit de traverser quelques rues et les cuisines les plus diverses sont à portée de main.
Cette constatation n’est cependant qu’une demi-vérité. Mondialisation ou non, certains apprêts doivent être dégustés sur les terres qui les ont vus naître et cette observation ne revêt nulle part autant de pertinence qu’à Beijing où deux restaurants se sont imposés comme des points de référence pour deux mets historiques de la cuisine chinoise : Da Dong pour le canard à la pékinoise et Jing Wu Zhen pour l’agneau de Mongolie entier. Dans les deux cas, vous ne trouverez pas ailleurs des préparations confectionnées de la même manière, quels que soient les eff orts déployés par les chefs qui ont quitté Beijing pour s’établir à travers le vaste monde. Il existe toutefois un stupéfiant contraste entre ces deux temples de la gastronomie, car l’un ruisselle de faste et d’élégance alors que l’autre témoigne d’une rusticité toute provinciale.
Da Dong. Une personne seule peut-elle atteindre, sans l’aide de quiconque, une notoriété telle que la simple mention de cet apprêt légendaire connu depuis des siècles fasse immédiatement surgir son nom à l’esprit ? Le chef Dong Zhenxiang y est parvenu, avec ses désormais huit restaurants à Beijing (auxquels il convient d’ajouter deux nouveaux établissements à Shanghai) qui sont devenus autant d’adresses synonymes de canard à la pékinoise. Comme il se doit, cette renommée n’est pas survenue par accident ou par le fait d’un heureux hasard. Dong a mérité ces louanges par des efforts d’une intensité extraordinaire et, comme tous les grands cuisiniers du monde, par une attention obsessionnelle portée au moindre détail.

l’un des salons privés du Da Dong.

l’un des salons privés du Jing Wu Zhen.

Une règle intangible du Da Dong : FAIRE RÔTIR LE CANARD SUR UN FEU D’ARBRES FRUITIERS.
Le père de Dong était un chef qui lui a transmis un profond respect pour les traditions de la table pékinoise et l’a incité à suivre les cours d’une école de cuisine. Sa formation s’est complétée par des stages dans divers restaurants de Beijing. Les diff érentes étapes de ce parcours – un héritage culinaire familial, un apprentissage dans les règles de l’art et un perfectionnement dans plusieurs établissements de renom – semblent familières lorsqu’elles sont comparées à la carrière naissante de grands chefs vénérés. Sa formation comportait cependant un obstacle de taille : elle s’est déroulée à une époque où l’État chinois gérait l’école de cuisine, possédait et exploitait les restaurants.
Manifestement, Dong disposait d’un esprit d’entreprise hors du commun. Dès que le carcan des restrictions imposées par le régime a commencé à se détendre en 1985, il a ouvert un premier restaurant. Lors d’un récent repas où nous avons partagé histoires et anecdotes, il était presque impossible de se représenter cet établissement tel qu’il le décrivait. Nous étions attablés dans le Beijing Da Dong, un temple de la gastronomie flambant neuf qui a coûté 1,2 milliard de yuans et est entièrement dédié au canard et au luxe, depuis son entrée majestueuse d’où s’élancent des sentiers éclairés d’une lumière bleue qui composent des labyrinthes jusqu’aux salons particuliers ordonnés autour d’étangs scintillants. Comment faire coïncider cette vision avec la description du premier restaurant de Dong alors qu’il était contraint d’éloigner la fumée qui s’élevait des canards rôtissants par de larges moulinets du bras ? À une époque où il luttait pour accumuler une somme suffi sante à l’achat d’un équipement de cuisine digne de ce nom, Dong lui-même était tous les jours aux fourneaux.
À l’évidence, il n’en va plus de même aujourd’hui. D’impressionnantes brigades se consacrent à la préparation et à la présentation des mets, en laissant à Dong le temps nécessaire pour se concentrer sur la conception de la carte, une activité qu’il appelle « recherche ». Sa cuisine a évolué pour associer des harmonies modernes aux traditions culinaires de Beijing, mais en conservant naturellement les principes fondamentaux du canard à la pékinoise.
Et quelles sont donc les règles intangibles qui président à la préparation du canard ? En premier lieu, éliminez d’office les fours chauff és au gaz, utilisés presque universellement ailleurs. Les canards cuits au gaz possèdent une peau dure qui ne répond pas aux critères de Dong. Dans tous ses restaurants, les canards sont suspendus avec le cou et la tête audessus d’un feu de bois d’arbres fruitiers. Il recourt
DEUX VERSIONS DU CANARD sont proposées, l’une accompagnée d’une sauce hoisin traditionnelle et l’autre servie avec du caviar.
exclusivement à des pommiers et des pêchers originaires des montagnes qui entourent Beijing. Les volatiles eux-mêmes proviennent d’un élevage de la région. Depuis le jour où il a ouvert son premier établissement, Dong travaille avec le même fournisseur, un fermier qui élève des canards depuis près de cinquante ans et n’a d’autre client que Dong. Le restaurateur s’assure ainsi de conditions constantes et d’une diète adaptée. Les canards présentent une taille optimale, ils sont nourris selon des normes sévères et soumis à de stricts contrôles sanitaires. Quotidiennement, 1200 canards qui ont atteint l’âge de 45 jours sont livrés aux diff érents restaurants de Dong.
Dès que la peau a acquis une teinte intense d’acajou, la coutume de la présentation et du découpage devant les convives est préservée. Des chefs gantés apportent le canard dans la salle et détaillent avec dextérité sa précieuse peau croustillante. Il existe deux écoles quant au « support », suprêmement important, destiné à accompagner le canard. La première ne jure que par les petits pains et l’autre par les crêpes. Da Dong appartient de manière prédominante aux tenants du second camp car, s’il ne doute pas qu’un support est indispensable pour se saisir de la viande, il est convaincu qu’il ne doit pas pour autant détourner l’attention de l’essentiel. Les crêpes extrafi nes correspondent à une description minutieusement choisie pour ces galettes qui ressemblent au pain oriental. Deux variations fi gurent sur la carte. La plus traditionnelle se compose d’une sauce hoisin et d’une armada de garnitures : échalotes, sucre blanc, ail réduit en purée, légumes en conserve, cornichons, radis et concombres, tous sélectionnés pour s’inscrire en contraste avec la richesse de la viande.
Une seconde version est toutefois disponible. Si le canard à la pékinoise classique est associé à une sauce hoisin, Da Dong en propose une interprétation unique et capiteuse, conçue en parfaite opposition à la douceur de la sauce habituelle et caractérisée par une saveur salée sous la forme d’une abondante portion de caviar noir. Rien ne doit interférer avec cette préparation superlative, hormis des sections de peau méticuleusement découpées, chacune supportant un petit monticule de caviar. Cette association emporte le canard à la pékinoise vers un territoire gastronomique entièrement inédit et délicieusement raffi né. Le caviar rehausse les accents fumés conférés par le bois qui seraient autrement masqués par la traditionnelle sauce hoisin. Une mise en garde cependant, ce mets doit impérieusement faire l’objet d’une commande préalable, car seuls trois canards au caviar sont servis chaque jour.
Même si l’inscription sur l’enseigne au néon qui surmonte la porte s’orne des mots « Da Dong Super Neat Roast Duck », le chef Dong propose également un large éventail de mets. En eff et, le menu, qui dépasse par ses dimensions les plus ambitieuses cartes des vins avec ses 50 centimètres de haut et son épaisseur de 138 pages, est un catalogue encyclopédique de la grande cuisine chinoise. Malgré son incroyable longueur, il est parfaitement adapté aux visiteurs étrangers, car il présente la photographie de chaque apprêt, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de comprendre la description pour imaginer un plat.


Au Da Dong, L’ORIENT RENCONTRE L’OCCIDENT.
Son nom ne figure pas sur l’enseigne lumineuse suspendue au-dessus de la porte, mais chaque bouchée de ce plat en rend la dégustation aussi indispensable que le canard : le crabe royal à la vapeur accompagné de vin de Shaoxing. Nous ne recommanderons jamais assez aux gourmets qui ne sont guère familiarisés avec le crabe royal – oui, Dong le fait venir d’Alaska – d’oublier les habituelles assiettes de salade de crustacés. Les crabes royaux sont de véritables monstres, à côté desquels les autres espèces paraissent lilliputiennes. Les morceaux de crabe sont enveloppés dans une préparation éthérée à l’œuf qui comprend un vin de riz vieux de vingt ans, des œufs de crabe, du bouillon et de l’huile de crevettes. La sauce aérienne accentue la saveur du crabe géant, copieusement servi.
Une dimension théâtrale fait partie intégrante du répertoire du Da Dong, y compris pour une traditionnelle soupe chinoise. Au lieu de la servir dans un grand bol et avec la louche habituelle, une coutume suivie même par les restaurants chinois les plus raffinés, Dong off re des portions individuelles d’une soupe aux œufs de seiche sous la forme de papillotes constituées de sacs en plastique transparent déposés sur des pierres brûlantes. Disposés devant chaque convive, les paquets de cette soupe qui bout à gros bouillons sont ouverts par les serveurs. Assurément, cette mise en scène possède un accent dramatique, mais les pierres permettent de maintenir à la température idoine la délicate soupe épicée.
À sa manière, le crabe royal incarne une rencontre entre l’Orient et l’Occident par la préparation dans un style chinois d’un ingrédient occidental. En revanche, le foie gras de Dong possède une inspiration presque entièrement occidentale, même s’il provient de Shanghai où il est produit par une entreprise sino-française. Quelle que soit son origine, son goût et sa texture sont classiques. Servi froid avec un glaçage aux cerises, cet apprêt ne renie aucunement ses origines françaises.
Alors que Dong rend fidèlement hommage à ses racines avec son emblématique canard à la pékinoise, l’influence de l’Occident est de plus en plus perceptible dans sa cuisine. Amateur passionné de whisky pur malt, il effectue chaque année un voyage en Écosse. Il pratique également la photographie avec son Hasselblad tant apprécié. Les bougies de son restaurant sont confectionnées en Allemagne et, naturellement, il porte une montre Blancpain à son poignet.

Un crabe royal cuit à la vapeur avec du vin de Shaoxing.

Soupe aux œufs de seiche; canard à la pékinoise accompagné de caviar.

Le chef Li Lin Yu
L’AGNEAU DE MONGOLIE remplit à lui seul la CARTE du Jing Wu Zhen.
Jing Wu Zhen. Un repas chez Da Dong pour savourer le meilleur canard à la pékinoise est un pèlerinage, qui demeure cependant facile à réaliser. Situés au centre de la ville, tous ses restaurants de Beijing sont aisément accessibles depuis les plus grands hôtels. En revanche, un dîner au Jing Wu Zhen exige de la force de caractère, une patience presque infi nie dans les embouteillages de la mégapole et un chauffeur expérimenté équipé d’un GPS tout aussi fiable. Le Jing Wu Zhen se trouve en effet au cœur de nulle part, à bonne distance du centre de Beijing, et il se dissimule dans un ordinaire immeuble d’habitation.
Ce n’est pas seulement en raison des deux heures de trajet depuis le cœur de Beijing (et cette durée ne se vérifie que lorsque tout va bien) qu’il apparaîtrait peu raisonnable de s’arrêter en passant. En effet, le restaurant accueille uniquement les hôtes qui ont procédé à une réservation préalable. D’ailleurs, le Jing Wu Zhen ressemble davantage à un cercle privé qu’à un établissement ouvert au public. Cette impression remonte à ses origines, car son propriétaire Zhang Jun Pu a instauré le Jing Wu Zhen comme un cercle privé destiné à ses amis. Une année plus tard, Zhang Jun Pu a progressivement ouvert aux gourmets les portes du Jing Wu Zhen. Sans aucune publicité. Sans figurer dans le moindre guide gastronomique. À l’évidence, sans site internet. Aucun avis publié sur TripAdvisor ou sur Yelp. Aucun « j’aime » sur Facebook. Avant de nous rendre au Jing Wu Zhen pour la première fois, nous avons lancé une recherche sur Google qui n’a donné… aucun résultat. Voilà qui nous ramène à l’essence même de la clandestinité. Même Google ne le connaît pas. La renommée du Jing Wu Zhen ne s’accroît que par le bouche à oreille.
Da Dong est célèbre pour son emblématique canard à la pékinoise et le restaurant tout entier s’articule autour de cet apprêt, mais sa carte de 138 pages abonde en mets additionnels. Le Jing Wu Zhen se concentre encore davantage sur une seule spécialité : l’agneau et rien d’autre. Splendide, succulent, intensément savoureux, magnifique et tendre.
Li Lin Yu, le chef de 27 ans, du Jing Wu Zhen, assure tenir sa recette d’un ami de son grand-père qui était le cuisinier personnel du général Tchang Kaï-Chek. En guise de cadeau, ce dernier lui avait offert cette recette écrite en tibétain. Comme Li Lin Yu vivait alors en Mongolie, il s’est mis à la recherche d’une
L’agneau de Mongolie EST SERVI ENTIER aux convives.
personne capable de la traduire et s’est imposé pour mission de la reproduire. Sa première tentative s’est soldée par un cuisant échec. Le mélange d’épices était erroné, l’agneau, trop âgé, était calciné, car Li se trouvait dans l’impossibilité d’en contrôler la cuisson. Pour compléter son humiliation, il a reçu une volée de bois vert de sa grand-mère irritée qu’il ait gâché un excellent agneau. Son deuxième essai s’est révélé moins lamentable, même s’il a été néanmoins désavoué par son grand-père, un peu plus indulgent toutefois que sa grand-mère. Au cours des trois années suivantes, Li a voyagé à travers la Mongolie, en cuisinant des mets rustiques dans des restaurants musulmans, tout en perfectionnant la recette léguée par son grand-père. En fin de compte, il a transformé la préparation à la broche dans un four d’argile par la cuisson lente d’un agneau entier sur un feu de bois de pommier disposé sur un socle de terre parfumée. Alors que la recette originale prescrivait de le frotter d’épices, une conception que Li n’a pas remise en cause, il a fondamentalement changé la composition de cet enduit en retirant le sucre et en ajoutant de nombreuses herbes et quelques plantes aux vertus médicinales. Au total, son mélange se compose aujourd’hui d’une cinquantaine d’ingrédients.
Aussi étudiée et épicée que la recette actuelle puisse paraître, l’agneau demeure au centre de l’attention. Li Lin Yu ne cuisine que des agneaux de lait venus de Mongolie. Ces animaux sont élevés pour leur fourrure et le chef est uniquement intéressé par les autres parties de l’agneau. Tous les jours, 22 agneaux sont livrés au Jing Wu Zhen. Ils sont suspendus pendant trois jours pour adoucir la viande et dissiper l’acidité des muscles avant d’être généreusement épicés. Le secret de ce mets réside dans la lenteur de la cuisson, Li Lin Yu dispose chaque agneau sur une grille au-dessus du feu pendant quatre heures. Au maximum, onze agneaux sont servis par repas.
À moins que vous ne soyez un carnivore vorace, le Jing Wu Zhen ne s’adresse pas aux dîneurs solitaires. En premier lieu, le restaurant ne propose pas de tables individuelles et le repas se déroule dans des salons

L’agneau est lentement rôti pendant quatre heures.
privés, tous décorés de thèmes mongols. Ensuite, il y a l’agneau. Bannissez l’idée de bouchées artistiquement composées en une mosaïque sur une assiette qui sera solennellement apportée sous cloche en salle. Le Jing Wu Zhen sert l’agneau entier, toujours étendu sur sa grille. Chacune des tables rectangulaires a été spécialement construite pour accueillir un agneau en son centre. À l’évidence, des assiettes et des baguettes sont disposées à chaque emplacement autour de la table, mais ce côté formel semble répondre davantage à un souci d’apparat et la main demeure l’outil privilégié. Des gants en caoutchouc sont proposés et tous les convives instruits dans l’art élémentaire de sélectionner et de déchirer de petites portions d’une viande succulente et à la délicate saveur épicée. Nul besoin d’un couteau, qui n’est d’ailleurs pas offert. Les mains dansent autour de l’agneau à la recherche de fragments croustillants ou de morceaux de choix à l’image du cou. L’unique accompagnement se compose d’un rustique pain plat cuit sur le même feu d’arbres fruitiers que l’agneau.
Il existe cependant une alternative à cet apprêt unique. Naturellement, il s’agit également d’agneau, en ce cas braisé dans du lait et du beurre. En accord avec les traditions du restaurant, il est aussi servi déployé au milieu de la table pour être dégusté avec des mains gantées. Les subtiles épices de la version grillée ont disparu au profit des délicates nuances de la viande. Aucune trace d’un goût de mouton prononcé qui repose généralement dans la graisse, sinon une impression de douceur et de tendreté, alliée à une texture qui se vaporise dans la bouche. La viande s’accompagne de trois sauces, mais pourquoi donc en faire usage ? Cet agneau ne ressemble à aucun autre et mérite de figurer au centre du repas par ses qualités intrinsèques. Grillé avec épices ou braisé ? La meilleure solution consiste à accomplir deux voyages dans l’arrière-pays. Beijing compte d’innombrables restaurants de toute nature. Toutefois, de la même manière qu’il serait dommage de voir la ville sans visiter la Grande Muraille et la Cité interdite, il serait tout autant regrettable de ne pas découvrir ces deux mets emblématiques de la cuisine chinoise impossibles à déguster ailleurs sous cette forme : le canard à la pékinoise du Da Dong et l’agneau du Jing Wu Zhen.

Quelques-unes des épices utilisées dans un mélange complexe.
Autres numéros
Sélectionner la langue
Ne manquez pas le dernier numéro
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles publications